Quand New Line courba sa ligne dans les nineties
Récit des hauts et bas du studio dont la devise « d’agressivité prudente » a bien failli couler le studio plus d’une fois.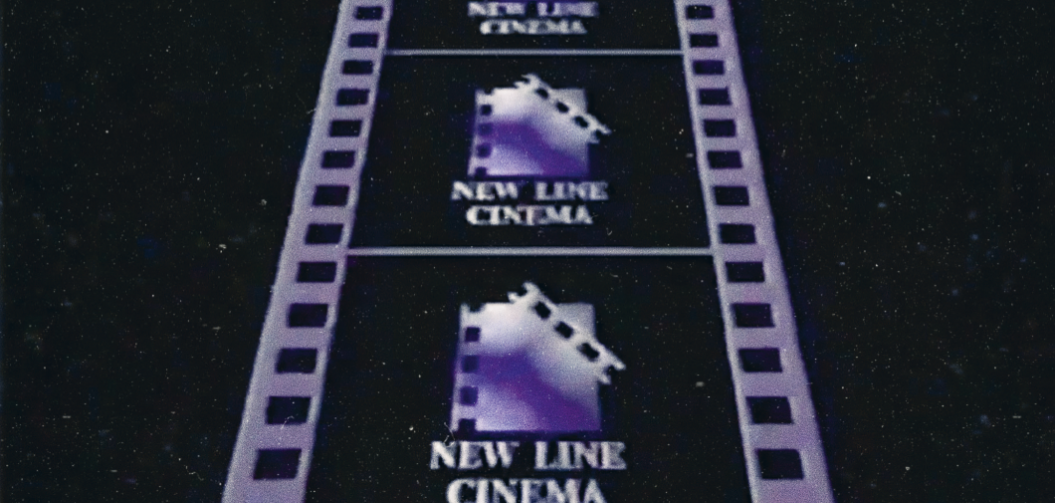
Dans les années quatre-vingt-dix, deux studios indépendants se disputaient les faveurs de la presse et d’un public spécialisé au box-office américain : Miramax et New Line. Alors que le premier a garanti Oscars et succès au box-office de manière constante, le second a pris beaucoup de tangentes pour changer ses aspirations artistiques. De Freddy à Magnolia, il y a eu deux conglomérats, un ado rebelle devenu nabab, un déménagement dans la Cité des Anges et beaucoup, beaucoup de rock’n’roll. En creux, les séries B auront autant pris de galon qu’elles perdirent de leur superbe, à travers les paris de Bob Shaye, Michael De Luca et des autres. Récit des hauts et bas du studio dont la devise « d’agressivité prudente » a bien failli les couler plus d’une fois.
Par Florian Etcheverry.
Article paru dans le Rockyrama n°25, toujours disponible sur notre shop !
Dans l’histoire de New Line Cinema, il est question de chiffres. Mais aucun, dans l’histoire de la compagnie, n’était aussi crucial que celui-ci : dix millions. C’est la somme maximale qu’était prêt à dépenser Bob Shaye dans l’investissement d’un film, afin de garantir les chances de dégager un profit : « sinon, on perd vraiment trop d’argent », expliquait-il. Un flair comptable qui a permis à la compagnie d’acquérir les droits américains de distribution pour des films européens – dont Au hasard Balthazar de Louis Malle –, dans les circuits universitaires ; mais aussi des midnight movies (Reefer Madness, La Nuit des morts-vivants) et autres films d’exploitation. Un esprit commando qui a permis à la société de se lancer dans la production sans passer par les compagnies hollywoodiennes, avant de rencontrer un succès national avec la série des Freddy, à commencer par Les Griffes de la nuit. À la fin des années quatre-vingt, New Line est devenu « la maison que Freddy a bâtie » et s’apprête à changer d’angle et d’ambitions.

L’année 1990 est une année charnière pour New Line, même si beaucoup de cinéphiles n’en ont pas forcément conscience à première vue. Tout d’abord, le fondateur de la compagnie, Bob Shaye – combinaison entre un âpre négociateur, un âpre critique et un bon vivant aux penchants bohémiens – amène officiellement un second aux commandes. Michael Lynne a connu Robert Shaye à la fac de droit de Columbia et avait passé la majeure partie des années quatre-vingt dans l’ombre, comme directeur juridique. Sous sa coupe, la société New Line est introduite en bourse en 1986. En 1990, Lynne est nommé président. L’arrivée de cette deuxième figure, dans un studio qui cultive son identité d’entreprise familiale, est surtout complémentaire de l’approche de Shaye, qui a tendance à éloigner les investisseurs et à mettre en garde contre les sirènes d’Hollywood. Mais cette usine à séries B et à imports alimentant les grandes métropoles ne peut plus se contenter de parier et de maximiser la mise à travers des campagnes de promotion ciblant des publics de niche. Ce n’est pas simplement une question d’ambition : malgré un marché vidéo qui permet de rentabiliser des flops en salle, les indépendants commencent à rencontrer de moins en moins de succès, voire à accuser la banqueroute, comme Orion Pictures. Une leçon à apprendre ainsi qu’un douloureux réveil pour New Line qui décide d’aller concurrencer les majors sur leur propre terrain… et d’ouvrir des bureaux à Hollywood.
Le deuxième événement majeur, qui entérine la volonté du studio de continuer à accueillir du cinéma d’auteur avec des ambitions plus commerciales, est la création de Fine Line Features en décembre 1990. L’épreuve du feu est réussie : Metropolitan de Whit Stillman, fabriqué pour moins de 250 000 dollars, rafle dix fois sa mise outre-Atlantique et décroche une nomination à l’Oscar du meilleur scénario. La même année, New Line acquiert les droits des Tortues Ninja, un film refusé par tous les studios et tourné de manière indépendante, avec l’aide de la compagnie de Jim Henson pour les créatures. New Line n’est pas habitué des films à destination des kids, mais décide de le sortir un beau jour de mars 1990, après l’avoir acquis pour une bouchée de pain. Une stratégie payante : 135 millions de dollars au box-office, et une franchise qui permet au studio de Bob Shaye d’entrer dans la cour des grands en coiffant au poteau les grands studios et en battant le record du film indépendant ayant engrangé le plus de recettes.

Il existe deux « slogans » pour New Line. L’un était officiel et martelé dans la presse lorsque Bob Shaye souhaitait les cajoler : « solidly independent » (fermement indépendant). L’autre, non officiel, était accroché dans le bureau du fondateur et ânonné par les cadres du studio : « de l’agression prudente ». Prendre des risques, oui, mais pas au point de provoquer un gouffre financier. Soutenir des cinéastes comme Gus Van Sant via Fine Line (avec My Own Private Idaho en 1991), d’accord ; mais pas au point de leur donner un chèque en blanc. C’est cette approche qui séduit les investisseurs et permet au studio de sauver la mise. Les budgets alloués au film et le marketing omniprésent, tendant à faire des films hollywoodiens des phénomènes de société, sont en train d’exploser : Last Action Hero et Jurassic Park sont en production et les conglomérats sont déjà propriétaires des principaux studios, de News Corp. à Time Warner. C’est alors qu’entre en scène Ted Turner.
Ted Turner est un magnat des télécommunications, plus connu pour avoir fondé un empire du câble tout au long des années quatre-vingt avec la chaîne d’informations CNN, mais aussi avec des robinets à rediffusion de vieux films et cartoons, à savoir TCM et Cartoon Network. Turner veut récupérer plus de catalogues comme celui de la MGM, ce qui l’a aidé à faire fructifier ses propres chaînes à peu de frais. De leur côté, Bob Shaye et Michael Lynne ont pour ambition de doubler leur production annuelle de films, tout en se passant des investisseurs volages qui peuvent retirer leurs billes au dernier moment. Ils cherchent donc un mécène et vont le trouver en la personne de Ted Turner, que Bob Shaye va appeler « notre banque ». « Les investisseurs voulaient que l'on continue sur notre lancée », mais avec cette nouvelle manne stable, ils peuvent accéder à des comédiens et réalisateurs de renom, tout en maîtrisant les coûts.

Que le meilleur gagne
En 1993, New Line devient donc une filiale de Turner aux côtés de Castle Rock Entertainment, compagnie qui sort du succès du film Des hommes d’honneur et qui ramènera, un an plus tard, Clint Eastwood dans un projet qu’il n’a pas initié – chose rare – avec Dans la ligne de mire. New Line a donc quelque chose qu’elle n’avait pas auparavant : un accès au star-system. Elle s’empresse de l’utiliser pour revitaliser la carrière d’un Robert Altman, alors exilé à Paris, avec la satire d’Hollywood The Player en 1992, puis avec Short Cuts en 1993, qui bénéficie d’un cast all-star, de Tim Robbins à Julianne Moore en passant par Robert Downey Jr., Andie MacDowell et Matthew Modine. Tout comme ceux de leur concurrent direct, Miramax, ces films bénéficient de l’appui des festivals de Cannes et de Venise, et d’une large couverture critique ; de quoi garantir un intérêt du public des grandes métropoles ainsi qu’un succès minimal d’exploitation. Le raisonnement de l’époque est le suivant : si un film New Line est un flop, il pourra toujours bénéficier d’une solide présence dans les boutiques de location en VHS, ou encore être multirediffusé sur les chaînes du groupe Turner. Une formule bien huilée qui va transformer Shaye, à son corps défendant, en dépensier avec un fort appétit.
Plus le film fera du bruit, mieux il se portera. L’adage est vieux comme le cinématographe. Il va s’appliquer lorsque – en voyant le succès retentissant de Boyz N the Hood de John Singleton couplé au succès mainstream des artistes Death Row à la radio et sur MTV (Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg) –, New Line va chercher deux frères d’à peine 21 ans, issus des quartiers de Los Angeles, pour tourner sur place un thriller dépeignant le monde des ghettos de Watts. Menace II Society aurait pu être bien différent, à en croire Allen et Albert Hughes alors qu’ils font la promo du film à la Quinzaine des Réalisateurs 1993 : « On voulait nous fourguer des personnages sympathiques et un happy end. Mais y a-t-il des personnages sympathiques dans Les Affranchis de Scorsese par exemple ? Plutôt ne pas aller sur le plateau que d’accepter de tels compromis. » Mais le système New Line n’est pas sans qualité : « Pour nous, c’est plus sûr de travailler avec eux, on est certains de faire le film qu’on veut », ajoutaient-ils. Un autre moyen de ne pas se couper du public urbain qui leur a beaucoup rapporté avec la franchise House Party, film d’exploitation par excellence avec le duo Kid’n’Play. Dans les deux cas, la recette est la même : pour s’assurer que le film rencontre son public, ne pas oublier de mettre en avant sa bande originale. Celle de Menace II Society mêlera à des artistes confirmés du gangsta rap, comme Spice-1, des talents moins exposés nationalement comme DJ Quik ou Da Lench Mob. New Line n’aura de cesse de lier les bandes originales de ses films au lancement de ses projets, surfant sur la vague des compilations de l’époque, et assurant aussi une couverture intéressée des médias hip-hop. Des facteurs qui contribueront aussi au succès de Friday en 1995, avec Ice Cube, aidé par le marché locatif friand de stoner comedies.

Jeu de masques
Pour rafraîchir son image et tenter de lancer de nouvelles franchises, celle de Freddy et des Tortues Ninja étant déjà arrivées à bout de souffle (temporairement, pour Freddy Krueger), Bob Shaye nomme un jeune et ambitieux producteur pour piloter les projets du studio. Michael De Luca, un gamin avide de comic books ayant grandi à Brooklyn, a quitté l’université au milieu des années quatre-vingt pour gravir les échelons de New Line. Il est l’un des premiers employés à quitter le QG de New York pour aller dénicher et évaluer des scénarios à Hollywood. En 1998, à seulement 29 ans, De Luca obtient l’assentiment de son « père adoptif » en affaires, Shaye, et a pour mission d'accroître les ambitions du studio. Pour ce faire, il va d’abord exaucer son rêve de gosse : faire produire un de ses scénarios de jeunesse par un John Carpenter alors sur le déclin (In the Mouth of Madness/L’Antre de la folie, 1993). Puis il met un pion sur un comique canadien qui fait quelques vagues sur la série télé à sketches In Living Colour, produite par les frères Wayans : Jim Carrey... Celui-ci commence à faire parler de lui début 1994, avec Ace Ventura, et un goût prononcé pour des performances énergiques et imprévisibles. The Mask réunit assez habilement tous les atouts du New Line de l’époque : un concept mêlant comédie romantique et film fantastique ; un réalisateur qui a la confiance de New Line, ayant déjà réalisé l’un des volets de la saga Freddy puis un film à effets visuels spectaculaires pour l’époque, fait à l’économie (The Blob), Chuck Russell ; et une gestion dispendieuse des effets spéciaux, commandés à ILM, qui entend prouver sa domination dans le domaine du morphing facial et de l’interaction avec des objets cartoonesques en 3D. Le tout pour moins de 30 millions de dollars. Un blockbuster à l’échelle de New Line, mais un quignon de pain à l’échelle de ses concurrents. En plus de s’arroger la découverte de Cameron Diaz, The Mask va aussi asseoir la réputation de New Line comme faiseur de stars. Carrey mènera sa barque et imposera Jeff Daniels dans Dumb & Dumber, lançant par là même la carrière des frères Farrelly. Le succès de The Mask à l’international fera oublier que l’autre pari de l’été 1994 pour New Line, un feel good movie avec des stars reconnaissables du grand public, sera un échec : Corrina, Corrina, avec Whoopi Goldberg et Ray Liotta.
Les films de De Luca courent avant tout après le public branché de la génération MTV, tout en ne renonçant pas à défrayer la chronique en lançant American History X ou Boogie Nights. De Luca est capable d’imposer David Fincher, qui voulait lâcher la réalisation suite aux difficultés rencontrées pendant Alien 3, à la tête de Se7en, qui met en scène Brad Pitt et Morgan Freeman, deux stars consacrées après Légendes d’automne et Les Évadés. Si le film atteint largement les 100 millions de dollars au box-office, la campagne pour l’Oscar (aidée par la présence du chef opérateur Darius Khondji et Howard Shore à la musique) se soldera par un échec. Qu’importe : le film gagnera trois MTV Movie Awards. Et New Line réussira à vendre le concept d’un serial killer se basant sur les sept péchés capitaux comme un film plus sophistiqué et plus edgy qu’il n’en a l’air. Pour le reste, ils laissent faire le bouche-à-oreille tout en prenant de l’avance sur les critiques négatives à travers la presse.

Une machine qui cale
Les cartons de Se7en et Friday laissent pourtant poindre une période de vaches maigres : l’année 1996. Aucun film ne sera plus représentatif de ce revers que L'Île du docteur Moreau, projet maudit tourné par un John Frankenheimer appelé en catastrophe, avec un cast peu inspiré en la personne de Val Kilmer et un Marlon Brando fatigué et dépressif. Une débâcle coûteuse pour la New Line, et un désaveu pour Michael De Luca qui a supervisé le film. Les contre-performances s’accumulent, y compris Au revoir à jamais d’un Renny Harlin revenant de la débâcle de L'Île aux Pirates. Les relations ne sont plus au beau fixe avec Ted Turner qui se dira publiquement « outré » de la sortie de Crash de David Cronenberg, qui n’était pourtant qu’une acquisition pour New Line et venait auréolé du prix du jury à Cannes. Un des cadres du studio balaiera la controverse, en affirmant : « on a sorti Crash exactement de la manière dont on le souhaitait »… mais en deux versions, l’une classée R et l’autre NC-17.
Bob Shaye n’est plus en position de force pour conserver son indépendance, alors qu’une nouvelle partie de chaises musicales se profile. Ted Turner s’apprête à intégrer le conglomérat Time Warner, en englobant toutes ses sociétés au sein de la compagnie. L’indépendance de New Line s’en trouve alors bousculée. Contre les vœux de Bob Shaye, inquiet de voir s’abattre les murs qui séparent New Line de ceux de la Warner Bros., Ted Turner convainc Time Warner de ne pas revendre le studio. New Line devient donc une filiale de Time Warner à 100% en 1996, mais garde son contrôle éditorial indépendant. De Luca parie à nouveau sur la comédie pour renflouer les caisses du studio, avec coup sur coup, The Wedding Singer, où Adam Sandler arrive à livrer une partition plus sensible que les films pour lesquels il était connu jusqu’alors, et Austin Powers, relecture bon enfant des films d’espionnage pop largement oubliés des sixties. La dextérité du marketing de New Line s’adresse d’abord aux enfants et préados, laissant les punchlines régressives de Mike Myers faire le reste. De Luca ira chercher un faiseur de clips pour faire fructifier l’association entre deux stars New Line : Chris Tucker, surfant sur le succès de Friday, et Jackie Chan, dont les films sont distribués par le studio. La formule Rush Hour va relancer New Line, aussi aidée par (quoi d’autre) la bande originale, recrutant des rappeurs bien connus du réalisateur, Brett Ratner, engagé pour son esthétique approuvée par MTV. New Line va aussi renouer avec la controverse et la censure en remontant Boogie Nights selon les desideratas du comité de la MPAA.

Les discrets films « art et essai » siglés Fine Line Features se heurtent à la logique implacable de Bob Shaye et Michael Lynne : « aucun loser chez nous ». Fini les jeunes talents à qui on donne une obole (exception faite de Harmony Korine), la division produira des Woody Allen et Paul Greengrass vite oubliés (respectivement Harry dans tous ses états et Envole-moi). Un franc-parler qui a été la source de beaucoup d’acrimonie en coulisses, alors que Jim Carrey ne reprend pas le rôle de Stanley Ipkiss pour la suite de The Mask et délaisse le studio qui l’a fait connaître. De Luca veut renouer avec l'âge d'or du Nouvel Hollywood et son esprit indépendant, et pour ce faire, il cherche l'équivalent de son Quentin Tarantino, pur poulain Miramax : un prodige alliant succès auprès de la critique à des performances solides au box-office et une base de public vouée à suivre ses projets. Paul Thomas Anderson sera le pari de De Luca : Boogie Nights est une ode ambiguë aux excès et à la déchéance des acteurs porno du milieu des années soixante-dix. Malgré des projections-tests houleuses, Anderson refuse de ramener le film sous la durée de trois heures. Quelques compromis plus tard, le film fait un triomphe à Toronto et se retrouve nommé pour trois Oscars. De Luca exulte : « Après avoir essuyé la pire année de notre histoire, j’ai présenté un scénario de 170 pages sur le milieu du porno dans les seventies, avec un héros au pénis XXL. Et [Bob Shaye] m’a laissé le faire. »
En 1998, New Line est revenu à l’équilibre entre de petits budgets destinés à un public féru de comic books (Spawn, Blade), des high concepts de science-fiction (Dark City, Lost In Space), et redevient une « destination » prisée d’auteurs indépendants. Mais la réputation du studio fait du bruit à Hollywood, où les fêtes garnies en alcool et drogue deviennent un secret de Polichinelle. À l’été 1998, la réputation du studio est même mise en jeu après une enquête de Première mettant en cause Michael Lynne et De Luca ; le premier pour harcèlement sexuel, le second pour avoir eu recours à des substances hallucinogènes durant de supposés séminaires de travail. Elle met aussi en lumière les problèmes chroniques d’alcool du fondateur du studio. L’enquête dépeint New Line comme un boys club implacable, où les cadres féminins « quittent l’entreprise sur un brancard », sujettes à des avances constantes de Shaye, Lynne ou De Luca. L’enquête est balayée par les cadres de la compagnie qui nient en bloc tout son contenu et attribuent les accusations à d’anciens employés amers cherchant à nuire à la compagnie sous couvert d’anonymat. Contrairement à l’affaire Weinstein qui éclatera des décennies plus tard, la plupart des témoignages accablants envers la hiérarchie sont alors le fruit de témoignages anonymes.

L’année suivante, Michael De Luca sera nommé « Showman of the year » par l’hebdomadaire Variety. Le parfum de scandale n’a pas nui à la santé de la compagnie, qui a délaissé peu à peu le genre – quasiment aucun film d’horreur n’aura été produit par la New Line après la fin de la saga Freddy pendant les années quatre-vingt-dix. Mais en s’insérant dans le studio system, Shaye parvient à faire marcher des concepts casse-gueule bien au-delà de leur public d’exploitation, tout en garantissant que des films plus radicaux puissent trouver un écho national, ainsi qu’en offrant une certaine protection contre les tentatives d’atténuer le propos (Menace II Society, American History X). Le succès de New Line Cinema est néanmoins teinté d'amertume : contrairement à Miramax, New Line a largement laissé filer les talents nourris par son écurie… Y compris Wes Craven, qui renouera avec le succès à travers Scream. De cette décennie quatre-vingt-dix, il restera des films plus marquants pour la culture mainstream et pour une certaine génération préadolescente ou adolescente, que pour leur inspiration artistique (The Mask, Austin Powers, Rush Hour). Comme n’importe quel studio d’exploitation des heures plus glorieuses des eighties, New Line aura su recycler ses stars de film en film ; comme Ice Cube, Mark Wahlberg ou Jackie Chan. C'est encore une équation maison, la même que pour un The Mask, qui aboutira au projet le plus ambitieux de son histoire : laisser un budget confortable à un réalisateur connu pour travailler sur une économie de films d'exploitation, autour d'un concept aisément vendable. Le président de Fine Line, Mark Ordersky, apprend que Miramax a mis en vente Le Seigneur des anneaux, alors en pré-production, et suggère le nom de Peter Jackson à Bob Shaye, ayant beaucoup aimé Créatures célestes. En 1998, la vision d’un pitch vidéo envoyé depuis Wellington convainc Shaye de donner le feu vert à une trilogie de films pour la bagatelle de 300 millions de dollars, d’après le livre d’heroic fantasy le plus populaire de tous les temps. Un Néo-zélandais avec un goût pour les films d’exploitation artisanaux, apte à travailler avec des contraintes budgétaires un appétit de franchise pour un studio friand de fidéliser son public = un autre risque payant. Une autre tendance établie pendant la troisième décennie d’existence de New Line : reprendre des projets refusés par l’ensemble des autres studios, présentés par pitié par des agents peu convaincus de leur produit, et en faire des succès. Ce qui pourrait être un autre slogan inavoué pour Bob Shaye et Michael Lynne : « Les derniers seront les premiers ».
Article par Florian Etcheverry.